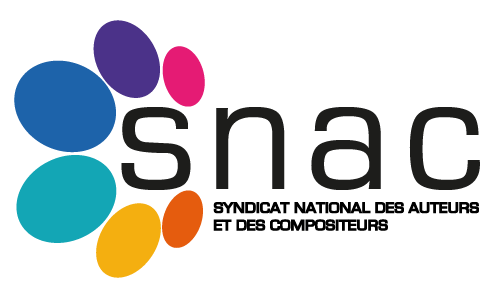Comprendre et maîtriser l’écosystème de l’industrie de la musique – Un entretien avec Nicolas Pansieri

Actualités Comprendre et maîtriser l’écosystème de l’industrie de la musique – Un entretien avec Nicolas Pansieri, compositeur de musique à l’image, membre du groupement Musiques à l’image. Bulletin des Auteurs – Comment aider un.e jeune compositeur ou compositrice qui souhaite se professionaliser ? Nicolas Pansieri – Nous aimerions proposer un panorama synthétique de l’écosystème de l’industrie de la musique, dont nous avons besoin en particulier pour la musique à l’image. Cette industrie est une jungle de concepts, de vocabulaire, de jargon professionnel. Derrière le vocabulaire se cachent à chaque fois des notions qu’il est important de maîtriser. Il peut s’agir d’identifier les acteurs de cette industrie, de comprendre les étapes du processus de développement professionnel, les étapes de la production d’un projet, etc. Tout cela représente une base nécessaire pour bénéficier d’un juste équilibre dans les rapports professionnels. Cette démarche est partie d’une expérience personnelle : je suis un compositeur en début de carrière, et je me suis confronté à cette masse importante de zones d’ombre et d’incompréhension. J’ai réalisé que je mettais le doigt sur quelque chose de crucial : un amateur peut avoir un aussi bon niveau artistique et technique qu’un professionnel ; ce qui les différencie (outre le réseau), c’est cette maîtrise des connaissances relatives à l’industrie musicale et à son fonctionnement, qui donne les armes pour évoluer dans ce milieu. Étant de nature opiniâtre, j’ai décidé de m’y plonger pleinement, d’acheter des livres sur le droit de la musique, sur l’organisation de l’industrie musicale, j’ai fait des recherches en ligne, croisé les informations et les sources… ce qui m’a évidemment demandé un temps, une énergie et un travail considérables. Grâce au tri de toutes ces informations, j’ai aujourd’hui la souplesse d’avoir rapidement accès à des réponses quand j’ai des doutes. Bien entendu… il faut avoir l’envie de se lancer dans une telle démarche… Si l’on ne dispose pas d’un minimum de connaissances globales sur le sujet, quand on est un.e jeune compositeur ou compositrice, on se retrouve dans des situations où l’on abandonne beaucoup de choses. Je suis convaincu que cela favorise la stagnation professionnelle, voire l’abandon de son projet au long terme. Lors de la concrétisation d’une collaboration, via un contrat par exemple, si l’on ne maîtrise pas les concepts en jeu on va se dire : « Eh bien tant pis, ce n’est pas grave, de toute façon ça viendra avec l’expérience. » Mais cette procrastination intellectuelle est pernicieuse : il est peu probable que cela vienne « avec l’expérience », comme par magie. Et c’est ainsi que l’on cède tout et n’importe quoi à l’éditeur ou au producteur qui est en face de nous. Cet interlocuteur n’est pas forcément malveillant dans sa démarche, mais a de meilleures connaissances sur le sujet, ainsi que des zones d’incertitudes, qui peuvent l’amener, par habitude, à user de certaines pratiques discutables. En se saisissant de ces sujets, on se donne les moyens de mieux communiquer, d’éviter de telles situations, ou a minima d’en prendre conscience. J’ai rejoint le Snac il y a presque deux ans, et en participant aux réunions de groupement, j’ai ressenti une sorte de fossé invisible avec les auteurs/ compositeurs établis, pour qui ces sujets sont soit acquis et relèvent de l’évidence, soit non acquis mais ne posent pas problème car leur notoriété professionnelle y supplée. J’ai partagé mon sentiment avec Maïa Bensimon et Yan Volsy, qui soutiennent mon idée de contribuer à démocratiser et rendre plus « horizontal » l’accessibilté et la progression vers la professionalisation. Louise Beuloir, stagiaire juriste au Snac, a aussi rejoint le projet et travaille à l’élaboration de supports qui serviront de base au webinaire. B.A. – La maîtrise du vocabulaire permet-elle d’aborder le concept ? N.P. – Le vocabulaire est un raccourci très efficace pour exprimer un concept possiblement complexe. Mais maîtriser du vocabulaire indépendamment des concepts qu’il désigne n’a pas de sens : l’un ne va pas sans l’autre. Il y a le vocabulaire, les acronymes, et le jargon. C’est au cœur du sujet du contrat de commande : ce contrat réunit plusieurs concepts de l’industrie de la musique liés à l’œuvre et aux cessions d’exploitation. Si on ne les maîtrise pas on ne peut pas maîtriser le contrat de commande. Mais les missions confiées au compositeur peuvent être plus larges : interprétation, enregistrement, mixage de la musique… Il est alors utile de maîtriser les notions liées à la production phonographique (fixation de l’œuvre sur un Master), distinguer les OGC spécifiques à l’activité donnée, faire le tri dans les notions de label, de maison de disques, ou encore la notion de droits voisins. Les confusions sont nombreuses, à cause d’une certaine complexité de l’écosystème, mais aussi à cause des anglicismes, de plus en plus présents dans le jargon. Or, ces termes anglais sont associés à des concepts et à la vision anglo-saxonne du droit d’auteur, de la production musicale, du Copyright. Par exemple, un « producer », terme très couramment utilisé dans les musiques actuelles, n’est pas un « producteur », mais plutôt un directeur artistique. Le terme « royalties » est utilisé comme mot « fourre-tout » par beaucoup de jeunes compositeurs, n’identifiant pas la différence entre droits d’auteurs, droits voisins, etc. Le monde du streaming, et le système des agrégateurs de contenu/ distributeurs en ligne, vient aussi ajouter de la confusion, puisque les plateformes sont pour la plupart hébergées dans des pays anglo-saxons. Enfin, il est important de se familiariser avec le jargon, notamment les acronymes, qu’il faudrait expliquer et décrire : OGC, Adami, Snac, Unac, U2C, Ircec, SCPP, Sacem, Spedidam, Ecsa, Afdas, organisations professionnelles, institutions (la liste est longue)… si l’on n’identifie pas ce que recouvrent ces acronymes on est vite submergé. B.A. – Vous préparez donc un webinaire sur ce sujet. N.P. – Nous nous proposons d’organiser un webinaire, sur un temps assez compact d’une heure, d’échanges entre compositeurs, avec une intervention externe d’un.e juriste issu.e d’une organisation professionnelle ou d’un OGC, et moi-même qui jouerais le rôle de Candide pour poser les questions. En parallèle, un travail est en cours pour produire de la documentation, notamment une infographie, la plus visuelle possible, qui pourrait
Une chronique du « Contre-sommet de l’IA : pour un humanisme de notre temps » – Un entretien avec Isabelle Seleskovitch
Actualités Une chronique du « Contre-sommet de l’IA : pour un humanisme de notre temps » – Un entretien avec Isabelle Seleskovitch, adaptatrice pour l’audiovisuel (doublage, sous-titrage) et autrice compositrice interprète (chanteuse, comédienne), représentante du groupement Doublage/ Sous-Titrage/ Audiodescription. Bulletin des Auteurs – Vous avez assisté au « Contre-sommet de l’IA : pour un humanisme de notre temps ». Isabelle Seleskovitch – Oui, qui a eu lieu au Théâtre de la Concorde le même jour que le « Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle » le 10 février 2025. L’initiative en a été prise par le philosophe Éric Sadin, en complicité avec Éric Barbier, journaliste à L’Est républicain. À eux deux, ils ont réussi à relayer au maximum l’annonce de cet événement et à y faire venir le public en grand nombre. Le but clairement affiché était de se mettre en dissidence contre le sommet officiel sur l’IA qui se tenait quelques dizaines de mètres plus loin au Grand Palais. J’ai ressenti dans la salle, qui était comble, une inquiétude généralisée, beaucoup d’anxiété, de questionnements et une recherche de solutions, là où il est encore difficile de poser des bases de réflexion concrètes et claires. En effet, nous sommes face à une (r)évolution numérique en marche, paradoxalement encore un peu balbutiante et en même temps frénétique dans son développement, puisque les technologies liées à l’IA et aux IA génératives évoluent de jour en jour. Pendant la majorité des interventions sur scène, j’ai eu le sentiment d’une grande tension politique et d’une volonté de rébellion vis-à-vis des dirigeants et des législateurs. Sur un ton très revendicatif, Éric Sadin a fait une longue introduction d’ordre didactico-idéologique qui pointait la « doxa », autrement dit l’idéologie qu’on cherche à nous imposer au sujet de l’IA, et qui s’appuie sur des grandes injonctions, notamment l’accélération, c’est-à-dire la nécessité que l’IA s’installe sans plus attendre (ni trop réfléchir) dans nos mœurs et pratiques, et ce dans l’obligation de rattraper notre supposé retard ; ou l’allégation qu’il ne faut pas douter de l’utilité intrinsèque de ce nouvel outil. Il a dénoncé un conflit d’intérêts caractérisé dans la composition du premier comité sur l’IA mis en place pendant le gouvernement d’Élisabeth Borne, avec la présence de certains tenants du développement industriel de ces technologies (Meta, Google, Mistral pour la France). Éric Sadin a donc appelé ce sommet « Contre-Sommet pour un humanisme de notre temps » pour avertir du changement total de paradigme en cours et à venir, et d’une menace très concrète pour notre humanité profonde à terme, au profit d’intérêts économiques ne profitant qu’à quelques-uns. B.A. – Quelle était la composition du public ? I.S. – Assez hétéroclite, des enseignants, des auteurs, des comédiens, un public qui reflétait les catégories socio-professionnelles qui sont touchées en première ligne. Parmi les intervenants sur scène figuraient des journalistes, des représentants syndicaux, des employés de la Poste et de France Travail, donc des fonctionnaires, mais aussi des scénaristes, graphistes, traducteurs ; en somme, des porte-parole de métiers en lien avec l’éducation, la culture et le service public. Les intervenants ont exposé ce qu’ils ont pu observer, dans leurs domaines respectifs, des évolutions induites par ce fait accompli du recours à l’IA, qui a fait irruption dans leur quotidien et dans leurs méthodes de travail, souvent sans qu’ils n’aient rien demandé. En premier lieu, le sociologue Fabien Lebrun, auteur de l’essai Barbarie numérique, a parlé des désastres écologiques et humanitaires liés à l’IA au Congo, avec les conséquences néfastes de l’exploitation du coltan nécessaire à la construction des serveurs (n.b. dans la même ligne et pour approfondir, je recommande le visionnage du documentaire édifiant Les Sacrifiés de l’IA sur France Télévision). Ensuite, le co-organisateur du sommet et journaliste Éric Barbier, également référent IA du Syndicat national des journalistes (SNJ), a alerté sur la publication de contenus éditoriaux conçus avec l’IA, illustrant la problématique avec un visuel comportant des erreurs grossières qui avait été choisi pour la Une d’un magazine de renom ; une employée de France Travail a détaillé les nouvelles mesures d’accompagnement des demandeurs d’emplois, qui substituent des algorithmes aux rendez-vous personnalisés avec votre conseiller, ce qui déshumanise des services conçus pour favoriser l’interaction personnelle, et entraîne des suppressions d’emplois ; des enseignants ont dénoncé l’incitation actuelle du ministère de l’Éducation et des IUFM à se servir de l’IA dans leurs contenus pédagogiques, sans aucune structure ni cadre définis, ce qui favorise le plus grand empirisme et les disparités dans les méthodes mises en place. Les interventions du monde enseignant ont donné lieu à une vraie effervescence et à des protestations appuyées dans la salle. La séance était informelle, et le temps manquait pour laisser la place à des échanges structurés entre public et intervenants, ce qui amenait les gens à intervenir de manière impromptue, passionnée mais parfois intempestive. J’ai pu me rendre compte que les problèmes générés par l’IA ne touchent pas seulement les métiers des artistes-auteurs, mais un large éventail de domaines professionnels, et que nous sommes tous concernés. B.A. – Des artistes-auteurs sont-ils intervenus ? I.S. – Des traductrices issues du domaine de la traduction technique, l’une du collectif En Chair et en Os, l’autre du collectif IA–lerte générale, ont relevé que l’IA intervient pour renforcer des problématiques déjà structurellement présentes depuis longtemps. En l’occurrence, dans ce secteur, les abus de la part des agences de traduction, qui bradent les services des traducteurs freelance. Toutes les contraintes dont ces derniers souffrent déjà, et contre lesquelles ils doivent se battre pour maintenir des conditions de travail décentes, sont aggravées par l’arrivée de l’IA. Ces traductrices ont souligné que devenir vérificateur d’une pré-traduction proposée par l’IA, c’est-à-dire vérifier un travail mal fait, est beaucoup plus long et fastidieux que de mener sa tâche avec ses propres critères de professionnalisme et de créativité. Elles ont préconisé soit le boycott pur et simple de l’IA, soit, si l’usage de l’IA leur est imposé, le sabotage, pour introduire des erreurs dans le matériau même de l’IA. Je suis personnellement réservée sur ce point, car, selon moi, quand on accepte un travail, le principe
Traduire les jeux vidéo – Un entretien avec Maxime Place

Actualités Traduire les jeux vidéo – Un entretien avec Maxime Place, membre du groupement Doublage, Sous-Titrage du Snac, et membre de l’Ataa. Bulletin des Auteurs – Vous traduisez des jeux vidéo. Maxime Place – À côté de mes activités en doublage, sous-titrage et voice-over, je suis en effet adaptateur de jeux vidéo. Je traduis les paroles échangées entre les personnages du jeu vidéo, mais aussi les divers textes qui s’adressent au joueur, à savoir les menus, les tutoriels, des descriptions d’objets, des descriptions de quêtes, qui ajoutent à l’histoire et à la narration la partie ludique du jeu vidéo. Ce qui s’adresse au joueur est souvent écrit : en passant votre souris sur un objet, vous ouvrez l’encart d’une description, qui est du texte brut. Par ailleurs certains jeux vidéo ne se prêtent pas au doublage, ils fonctionnent encore avec des fenêtres de dialogues. Les grosses productions tendent de plus en plus à demander doublage et sous-titrage, mais un budget peut être insuffisant, ou un type de jeu peut ne pas appeler l’usage des voix. On reste alors sur du texte pur. Pour le texte brut, on vous fait traduire le segment que l’on vous confie sur un logiciel qui peut proposer une pré-traduction à partir de sa base de données. Pour le sous-titrage ce sera la même méthode, sauf qu’en jeu vidéo on n’applique pas vraiment les normes en vigueur au cinéma ou dans les séries. Dans le jeu vidéo, très souvent vous n’avez pas l’image, seulement le texte en VO, que vous devez traduire en respectant plus ou moins un nombre de caractères par ligne, ce qui pose des problèmes de lisibilité, si vous avez 120 caractères sur une ligne, ce qui est bien long, ou si 40 caractères sur deux lignes correspondent à 1,20 seconde du jeu, ça rend le tout difficilement lisible et l’on perd la dimension synthétique, voire artistique, du sous-titrage. Pour le doublage existent plusieurs méthodes. Soit on vous demande de faire de la synchronisation audio : vous avez l’extrait audio, sans l’image, quand vous traduisez vous devez rester dans les clous audio. Si le personnage parle durant deux secondes, il faut que lire la traduction prenne deux secondes. Une deuxième méthode est de faire de la traduction en synchronisation labiale, qui aligne les dialogues traduits sur les mouvements des lèvres des personnages, juste à partir de la vidéo, c’est-à-dire à la volée, à vue. Une troisième méthode consiste à faire pré-traduire par un traducteur classique, et ensuite à envoyer cette traduction à des adaptateurs, qui vont légèrement modifier le texte pour l’adapter à une bande rythmo. Il existe probablement une poignée de studios qui travaillent directement sur rythmo, comme en doublage, mais c’est une pratique assez marginale. Le choix entre ces différentes méthodes est une affaire de budget et de coût. Payer la traduction d’un texte de 6 à 8 centimes le mot, puis une adaptation à 15 euros la minute, cela revient moins cher que payer 30 euros la minute à un auteur de doublage, qui travaille directement sur la bande rythmo. B.A. – En jeu vidéo, comment s’organise la traduction ? M.P. – Suivant les jeux il y a un nombre immense de mots à traduire, qui peut dépasser le million. Comme nous sommes dans une industrie où tout doit être fait très vite, on divise cette somme de mots en segments de cinq, dix, quinze, vingt mille mots, qu’on distribue à différents traducteurs. L’utilisation du logiciel évite d’avoir à établir une gigantesque « bible », même si on le fait quand même parfois par précaution. B.A. – Qu’est-ce que la « bible » ? M.P. – La « bible », en jeu vidéo comme en doublage ou en sous-titrage, est un document qui va regrouper plein d’informations sur l’univers du jeu, vous y trouvez un trombinoscope qui déroule un panorama des personnages, leur nom, leur rôle, un tableau des « Tu » et des « Vous », afin de savoir quels personnages se vouvoient ou se tutoient, un glossaire détaillé du jeu, des informations sur le contexte, etc. Ainsi, si vous arrivez sur un projet qui a déjà publié une ou des saisons, ou qui demande une mise à jour, vous n’êtes pas perdu.e. B.A. – Comment s’articule votre travail avec l’utilisation du logiciel ? M.P. – Grâce au logiciel, et à son glossaire intégré, vous pouvez aller voir le travail du collègue, comment est-ce qu’il a traduit ce terme. Le logiciel construit ainsi une base de données, et est en mesure de proposer parfois des pré-traductions, sur la base de vos propres traductions précédentes et des traductions précédentes de vos collègues. Parfois en effet, vous pouvez avoir les mêmes mots, voire les mêmes fragments de segments, qui reviennent dans le jeu. Mettons que dans le jeu vous ayez dix vendeurs, chaque vendeur va dire : « Bonjour Voyageur, comment allez-vous ? », ce fragment de segment va donc apparaître dix fois, et la pré-traduction va vous être proposée dix fois. Le souci, c’est qu’en tant que traducteurs/ auteurs, on ne va pas se contenter de traduire cette phrase de la même façon à chaque fois, on va forcément trouver des variations qui colleront plus au contexte ou aux personnages. Si le logiciel détecte que le segment que vous traduisez est semblable par exemple à 80 % à un segment préalablement traduit, et vous en propose une pré-traduction, dans votre rémunération ce segment vous sera par exemple payé 30 % en moins de votre tarif parce que vous avez bénéficié d’une pré-traduction. C’est ce fameux système de « fuzzy grid » qui est hérité de la traduction pragmatique (juridique, technique, médicale…), et qui est une aberration en traduction de jeux vidéo, où l’on s’efforce de retravailler la pré-traduction le plus possible, pour créer une vraie immersion dans le jeu, et pas simplement un copier-coller prémâché et répétitif. En jeu vidéo, contrairement au cinéma ou aux séries, on travaille souvent sur un projet qui n’est pas terminé. S’il n’y a pas d’images ni de bible de développement, énormément
Les changements dans notre métier – Un entretien avec Marco Attali

Actualités Les changements dans notre métier – Un entretien avec Marco Attali, créateur de chansons, musicien, compositeur, parolier, interprète, responsable du Groupement Musiques Actuelles et Président de la Commission des Programmes Sacem. Bulletin des Auteurs – Avez-vous accès au contrat de commande en tant que créateur de chansons ? Marco Attali – Quand on écrit des chansons, on n’a pas de contrat de commande. Quand on compose de la musique d’illustration ou d’habillage, que d’aucuns appelaient jadis, d’une manière un peu péjorative, « musique d’ascenseur », on peut dire aussi musique d’ambiance, c’est devenu un peu le même cas, malheureusement. Quand on avait une demande de la part d’un éditeur de Librairie musicale, spécialisé en musique d’habillage, on lui fournissait la composition et l’enregistrement, c’est-à-dire le Master, en contrepartie de l’enregistrement nous recevions une espèce de prime. Même si l’on signait un accord en amont, ce n’était pas vraiment un contrat de commande. Et n’importe comment, cela a pratiquement disparu. En ma qualité de membre de la Commission des Programmes de la Sacem, nous avons constaté, les commissaires et moi-même, que la plupart des musiques d’illustration utilisées en fonds sonores, génériques, etc…, sont éditées par les chaînes diffuseurs, ce qui impacte fortement les revenus des créateurs, vu ce principe d’édition coercitive. Dans ma spécialité de créateur de chansons, on pouvait avoir un contrat avec un éditeur, avec une avance éditoriale, et la fameuse clause de préférence, qui vous oblige à lui proposer toutes les œuvres que vous créez. Il y avait un contrat en amont, mais ce n’était qu’une avance éditoriale, ce n’était pas une prime ni un contrat de commande. Cela aussi se fait de plus en plus rare. À une certaine époque, l’éditeur avec lequel on avait signé un contrat préférentiel pouvait vous mensualiser. Une telle mensualité pouvait atteindre mille euros par mois pendant la durée du contrat. J’en ai bénéficié. C’était également considéré comme une avance. En tant que créateur de chansons, je n’ai pas de contrat de commande, je ne touche que des droits d’auteur, même si je fournis le Master. Je ne touche pas de prime pour l’enregistrement. Hors d’un contrat préférentiel avec un éditeur, point de salut, en quelque sorte. Hors contrat, je ne suis lié à personne, mais c’est à moi de trouver la personne susceptible d’utiliser ma chanson. Mais là aussi c’est de plus en plus compliqué. Quand on signait, comme créateur de chansons, un contrat avec un éditeur, une major comme Sony, ou autres, c’est eux qui s’occupaient de placer vos chansons. En tant que responsable du groupement Musiques actuelles, je me rends compte, par rapport à voici quelques années, lors de nos réunions, qu’il n’y a pratiquement plus personne. On se retrouve en visio, on est quatre, cinq grand maximum. Que ce soit dans le rap, la variété, la pop, la musique urbaine, il y a de moins en moins de créateurs de chansons, maintenant les artistes-interprètes écrivent eux-mêmes leurs textes et leurs musiques. Ce sont eux qui touchent des droits d’auteur s’ils réalisent un succès. Être uniquement créateur de chansons ne génère pratiquement plus de droits d’auteur. J’ai la chance d’avoir eu un succès, « T’as le look, Coco », qui me rapporte toujours des droits d’auteur. Mais on ne place plus une chanson comme avant, quand un créateur de chansons et un.e artiste-interprète demeuraient fidèles l’un.e à l’autre. Quand une telle fidélité se créait, cela ne passait même pas par une major éditoriale, c’était un accord direct. Ça n’existe plus du tout. Désormais il faut être obligatoirement en contrat avec une major. Si moi je crée une chanson et si j’essaie de la placer directement, je n’ai absolument aucune chance. Avoir parcouru une carrière conséquente ne signifie plus rien aujourd’hui. Les chansons que je crée dorénavant, c’est pour moi. Je suis parolier, compositeur, interprète, producteur, éditeur. Si la chanson est une création à plusieurs, il y a des cosignataires. Pour les créateurs émergents ce n’est pas évident de rentrer dans le métier. B.A. – L’intelligence artificielle vous inquiète-t-elle ? M.A. – Avec l’intelligence artificielle, ça va être terrible. Si un réalisateur d’émission a besoin d’un générique, il ne va plus faire appel à un compositeur, il va appuyer sur le bouton du logiciel et dire : « Je veux une musique avec des cordes, style Mozart », il va l’avoir en cinq minutes. On ne pourra pas arrêter ce mouvement. Un label qui distinguerait les œuvres non créées par l’IA ne servirait pas à grand’chose. Le public s’en ficherait. Il faudrait trouver un moyen de rémunérer les créateurs pour leurs œuvres à partir desquelles l’IA fait sa cuisine. Le 12 octobre 2023, la Sacem a annoncé qu’elle exercerait son droit d’opposition (« opt-out ») afin de contrôler l’utilisation de son répertoire par des Intelligences Artificielles (IA) génératives. Cette mesure vise à protéger les droits d’auteur dans un contexte où les technologies d’IA exploitent souvent des œuvres sans autorisation ni rémunération. Comment redistribuer ensuite la somme parmi les créateurs, cela resterait à inventer. La Sacem y réfléchit. On va avoir des gens qui vont créer une composition avec l’IA et qui vont essayer de la déposer en tant que créateurs à la Sacem pour toucher des droits. Il faudrait un logiciel IA qui repère de l’IA. Pourquoi pas ? Il y a encore quelques années on se rendait compte quand c’était fabriqué avec l’IA, parce qu’avec le son ce n’était pas tout à fait ça, il y avait des erreurs, aujourd’hui l’IA est de plus en plus performante, on a du mal à reconnaître ce qui est faux. J’ai un ami qui m’a fait une démonstration avec une chanson de Charles Aznavour, une chanson qui existe. Il a séparé la voix, parce que maintenant on peut le faire, des arrangements. Avec l’IA il a rentré la voix toute seule de Charles Aznavour dans la mélodie de la chanson, et il a demandé à l’IA de faire une mélodie qui ressemble à cela, avec un texte qui ressemble au texte que dit la voix d’Aznavour, avec le son
Un appel d’offres pour l’organisation du festival d’Angoulême – Un entretien avec Marc-Antoine Boidin

Actualités Un appel d’offres pour l’organisation du festival d’Angoulême – Un entretien avec Marc-Antoine Boidin, scénariste, dessinateur et coloriste de Bande dessinée, responsable du groupement « Bande dessinée ». Bulletin des Auteurs – Quel est le bilan du festival d’Angoulême ? Marc-Antoine Boidin – Cette année nous avons élargi notre terrain d’intervention. Comme d’habitude nous avions l’espace des auteurs et des autrices de BD, à la Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, et nous avons inauguré l’espace de la nouvelle création. Nous y avons proposé une table ronde sur le sujet des débuts professionnels dans la BD, grâce à des retours d’expérience d’auteurs et autrices plus confirmés, qui ont raconté comment ils avaient débuté leur activité. Le public regroupait une soixantaine de spectateurs, des auteurs amateurs qui songent à devenir professionnels, et des scolaires, sachant que les personnes qui assistaient sont assez passionnées de BD et souvent rêvent de devenir auteurs aussi. Ils ont ainsi découvert l’existence du Snac et de notre contrat BD commenté. Ainsi de futurs potentiels auteurs et autrices ont pu recevoir des informations utiles. À la CCI, le jeudi après-midi, en lien avec l’AGrAF, les Auteurs Groupés de l’Animation Française, et L’A., l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, nous avons proposé un « speed dating », c’est-à-dire des rencontres, entre auteurs de l’écrit et auteurs de l’image, pour des projets de BD ou des projets d’animation. L’idée était que des rencontres puissent avoir lieu, et des projets communs émerger ensuite. Ce n’est pas évident, surtout pour des scénaristes, de rencontrer des dessinateurs ou dessinatrices. Provoquer de telles rencontres est une manière de rompre l’isolement. Ils ont pu ainsi échanger sur leurs projets ou leurs souhaits, l’occasion aussi pour le Snac de les informer sur les droits d’adaptation qui sont systématiquement associés aux contrats d’édition. Permettre aux auteurs et autrices de penser dès le départ à ce qu’il pourrait advenir de leur projet. Artistiquement certes, mais aussi en termes de périmètre de contrat. Le vendredi nous avions notre journée professionnelle, avec une table ronde autour de la phobie administrative, qui donnait des informations sur ce qu’il faut faire, ce à quoi il faut penser, et qui avait pour objet de donner des clefs pour éviter cette peur des papiers à remplir, des formulaires à envoyer, pas toujours simples à comprendre, et pour lesquels on n’a pas forcément une appétence particulière. Le vendredi après-midi nous avons échangé autour du contrat numérique et de la question des intelligences artificielles, à propos de quoi Maïa Bensimon, déléguée générale du Snac, est intervenue. Des clauses mentionnant l’IA commencent à apparaître dans les contrats, heureusement pour s’en défendre, éditeur comme auteur. Cependant nous devons être vigilants sur ces nouveaux points qui sont abordés dans les contrats. Le contrat, papier et numérique, étant la pierre angulaire du confort (ou non) dans lequel nous exercerons notre métier, le sujet est primordial. Même si le contrat concerne l’œuvre, il génère les conditions de travail de l’auteur, sa rémunération, ses délais, le périmètre des droits qu’il aura cédés. Enfin, Maïa Bensimon a tenu une permanence juridique le jeudi après-midi. B.A. – Le Conseil permanent des écrivains demande que l’organisation du festival d’Angoulême bénéficie d’un appel d’offres. M.-A. B. – Le festival d’Angoulême est souvent l’objet de polémiques, car il est le plus important événement BD de l’année et il cristallise les tensions, notamment syndicales, puisque c’est le moment où nous sommes visibles, donc où nous pouvons faire remonter des problématiques. Un article du journal « L’Humanité Magazine » pointait, le 23 janvier dernier, certains scandales autour de l’organisation du festival, et de la société « 9eme art+ » qui le gèrent. Cette gestion de l’organisation du festival est problématique, elle nuit à son image et à l’image de la bande dessinée en général. C’est à l’occasion d’un précédent scandale qu’avait été créée l’ADBDA (Association pour le Développement de la BD à Angoulême) où les institutions publiques locales, régionales, nationales, qui financent le festival, se réunissent pour rédiger un Contrat d’objectifs et de moyens. Les auteurs avec le Snac comme les éditeurs, SNE (Syndicat National de l’Edition) et SEA (Syndicat des éditeurs alternatifs), y siègent, mais à titre consultatif. C’est dans cette association que nous avons pu défendre la rémunération des dédicaces au FIBD, la parité dans les jurys ainsi qu’un espace dédié aux autrices et aux auteurs. Trois structures différentes se croisent dans la conduite du festival : l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême ; l’Association historique qui a créé l’événement, et qui est propriétaire de la marque « FIBD » ; la société « 9e Art +», à laquelle l’association FIBD a confiée l’organisation du festival. La société « 9e Art +», du fait de son contrat avec l’association FIBD, qui dure jusqu’en 2027, n’est pas mise en concurrence avec d’autres sociétés. Le financement public du festival représente 45 % de son budget, c’est pourquoi il a pu ne pas y avoir d’appel d’offres (à partir de 50 %, un tel appel d’offres est obligatoire). Un appel à projets en revanche est possible et permettrait de construire un festival en adéquation avec l’ensemble des partenaires publics et de l’interprofession. Il y a un en outre consensus entre les éditeurs, les auteurs et les pouvoirs publics pour que cet appel à projet soit mise en place. Le DG de « 9e Art + » est aussi propriétaire d’une société, « Partnership Consulting », qui cherche des partenariats pour le financement du festival. Il n’y a aucune transparence sur le choix des sponsors que nous découvrons le jour de la conférence de presse. Cela crée de l’incompréhension, et des frictions avec les valeurs auxquelles peuvent s’identifier les auteurs de bande dessinée. B.A. – Parmi les scandales évoqués ont été mentionnées des violences sexistes et sexuelles. M.-A. B. – Ce sujet nous préoccupe et nous concerne. Dans notre secteur, il a été lancé par le collectif des créatrices de BD déjà avant « #MeToo ». Nous devons donc prendre en main urgemment et collectivement ces questions des VHSS (Violences et Harcèlements sexistes et sexuels). Dans nos relations interprofessionnelles, ce fut l’objet de notre colloque à l’Adagp en Avril sur les « Dérives
Une musique pour le Snac – Un entretien avec M!sty

Actualités Une musique pour le Snac – Un entretien avec M!sty, autrice compositrice interprète, membre du groupement Musiques actuelles. M!sty, jeune autrice compositrice interprète, a composé une musique pour la ligne téléphonique du Snac, afin qu’une attente éventuelle devienne des plus agréables. Bulletin des Auteurs – Comment avez-vous été choisie pour être la compositrice de cette musique ? M!sty – Je suis la plus jeune compositrice parmi les compositeurs et compositrices qui sont membres du Snac. B.A. – Quel a été votre itinéraire ? M!sty – J’ai commencé à composer vraiment à l’âge de treize, quatorze ans. Ma sœur m’avait appris un peu à pianoter pour accompagner la voix, je suis autodidacte pour l’écriture comme pour la composition, j’ai pris deux cours, à tout casser, de MAO, musique assistée par ordinateur, sur le logiciel Ableton. J’ai enregistré un premier album chez un ami, qui a un studio, j’ai sorti cet album à l’âge de dix-sept ans, « Paradoxe », en même temps que j’ouvrais ma chaîne YouTube, c’est là que je poste le plus, j’ai soixante-dix vidéos actuellement. J’ai depuis sorti plusieurs singles, je suis présente sur toutes les plateformes. B.A. – Comment avez-vous composé cette musique pour le Snac ? M!sty – De base j’écris des chansons. J’avais plusieurs compositions libres de paroles, que j’avais créées grâce à mon logiciel Ableton. Je compose sur ce logiciel de son depuis plus d’un an maintenant, je commence à bien le maîtriser. J’ai proposé au Snac plusieurs musiques. Celle qui a été retenue, je l’aime bien, elle a été écrite voilà quelques mois. Je l’ai retravaillée pour le Snac. Elle dure deux ou trois minutes, avec une boucle de quinze à vingt secondes, pour être répétée lors des appels. B.A. – Comment avez-vous été amenée à adhérer au Snac ? M!sty – Comme j’allais devenir majeure, j’ai voulu me syndiquer. Comme à la base je suis assez militante, je trouve que c’est très important de se syndiquer. Ma mère s’est renseignée, et m’a aidée dans les démarches dès que je suis devenue majeure. Ça m’est arrivé plusieurs fois d’avoir des contrats avec des maisons de disques, on a un peu de mal à les lire si on n’a pas de formation en droit. Les producteurs et éditeurs ont souvent une façon de faire comme s’il y avait un seul contrat possible, alors qu’en réalité pas du tout, il y a mille façons de faire. Le site du Snac propose des contrats types, qui m’ont été très utiles autant pour appréhender ma présence dans l’industrie musicale, que pour en apprendre davantage sur le droit d’auteur. J’ai bénéficié de la possibilité de faire relire mes contrats, avant de les signer, par le Snac. En cas de tension éventuelle avec un producteur ou un éditeur, il est important de se savoir soutenue. Il faut soutenir une organisation qui nous soutient. Si elle ne me soutient pas moi maintenant, que je soutienne le syndicat servira à d’autres personnes qui sont dans des cas qui ressemblent au mien.
La Commission de médiation entre auteurs et éditeurs – Un entretien avec Gérard Guéro

Actualités La Commission de médiation entre auteurs et éditeurs – Un entretien avec Gérard Guéro, scénariste de Bande dessinée, représentant du groupement Bande dessinée. Bulletin des Auteurs – La Commission de médiation entre auteurs et éditeurs est-elle près de voir le jour ? Gérard Guéro – Nathalie Orloff, en charge du répertoire de l’écrit à la Scam, avait l’année dernière accordé un entretien au « Bulletin des Auteurs », qui présentait parfaitement la genèse et la situation de la Commission de médiation entre auteurs et éditeurs. L’accord interprofessionnel conclu le 1er décembre 2014 entre le CPE et le SNE employait le terme de « Commission de conciliation ». Commission qui ne vit jamais le jour. Un débat a eu lieu, pour savoir s’il allait s’agir d’une conciliation, ou d’une médiation. Une conciliation et une médiation, ce n’est pas la même chose. Le conciliateur est un auxiliaire de justice, il peut donner son avis, exercer une action plus forte dans la recherche d’un accord. Dans la médiation, le médiateur aide les deux parties, qui exposent leur version et leurs demandes, à s’écouter mutuellement, à trouver un terrain d’entente. Dans la conciliation comme dans la médiation, ce qui a été dit devant le médiateur comme l’avis du conciliateur ne peuvent être invoqués dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des deux parties. C’est la médiation qui finalement a été adoptée. Parce qu’elle est moins onéreuse pour les auteurs, qui ne pourraient supporter des frais trop importants, et parce qu’un modèle de médiation existe déjà, celui de l’Amapa, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, dont la mission est de faciliter le règlement des litiges entre auteurs et producteurs du secteur du cinéma et de la télévision. L’Amapa fonctionne depuis longtemps, et très bien. Elle dispose d’un retour sur expérience. Créer une structure proche de l’Amapa est une bonne solution. Cela ne correspond pas à ce qui était demandé en 2014, mais ce sera une belle avancée tout de même. La médiation coûte 150 euros à chacune des parties, ce qui est abordable. Bien sûr, il faut trouver le financement de la structure, pour assumer un bureau, un salaire à mi-temps, qui permette de tenir les registres des médiations. Une fois par an, le médiateur doit établir un rapport, de manière anonymisée, qui répertorie les médiations qui ont eu lieu, les litiges qui ont été exposés. Trouver le financement de cette structure entre dans le cadre de la mission des OGC, et notamment de la Sofia, qui regroupe les auteurs et les éditeurs. B.A. – A-t-on une idée de l’ampleur des médiations qui pourraient être demandées ? G.G. – Une estimation est difficile à avancer. Ce qui est important, c’est avoir la structure, qui permette la saisine. Les auteurs peuvent être conseillés par leurs organisations professionnelles, qui sont favorables au principe de la médiation. Avant la médiation, auteurs et éditeurs peuvent essayer de se mettre d’accord directement. Mais qu’une médiation soit possible permet de se dire qu’il y a un recours si un accord direct n’émerge pas. L’existence d’une telle structure incitera à s’en servir. L’audiovisuel l’a, pourquoi le secteur du livre ne l’aurait pas ? B.A. – Nous touchons au but ? G.G. – Le SNE et le CPE approchent de la finalisation de ce projet. Depuis 2014, il n’est que temps. Mais qu’il s’agisse du suivi des ventes avec « Filéas », de la rémunération des auteurs et autrices de Bande dessinée en dédicace, des grands chantiers que nous mettons en route, le temps que cela fasse son chemin, que Marc-Antoine Boidin soit élu pour nous représenter à la Sofia, afin d’en parler et de pouvoir convaincre, nous sommes sur du temps long. Il faut se colleter à ces questions, parce que, au bout d’un moment, cela aboutit.
Une journée autour des Dérives comportementales – Un entretien avec Gaëlle Hersent

Actualités Une journée autour des Dérives comportementales – Un entretien avec Gaëlle Hersent, dessinatrice de Bande dessinée et illustratrice, représentante du groupement « Bande dessinée ». Le 1er avril dernier, l’ADAGP a accueilli une journée organisée par le Snac-BD autour des Dérives comportementales. Bulletin des Auteurs – Cette journée s’inscrit dans un long processus. Gaëlle Hersent – Nous travaillons sur ce sujet depuis plusieurs années. Une réflexion a d’abord été conduite avec Muriel Trichet, psychologue clinicienne, sur ce qu’est une dérive comportementale. Cinq brochures ont ensuite été publiées, chacune confiée à un.e spécialiste : « Une perspective psycho-sociale », une étude de Muriel Trichet ; « Une perspective sociologique », par Pierre Nocérino, docteur en sociologie à l’EHESS ; « Une perspective juridique », par Maïa Bensimon, alors responsable juridique de la SGDL ; « Une perspective historique », par Jessica Kohn, docteure en histoire contemporaine ; « Une perspective économique », par Olivia Guillon, maître de conférences en économie à l’Université Sorbonne Paris Nord. Une première table ronde a réuni, à part Jessica Kohn, qui n’a pu se libérer, les quatre autres personnes, auteurs de ces brochures. Cela a permis un dialogue entre elles, leurs interventions ont pu rebondir les unes avec les autres, nous avons pu voir tous les liens entre les différentes perspectives, comment l’économie influe sur le psycho-social, ou sur le juridique, comment tout est imbriqué. Nous avons pu comprendre comment, autour des dérives comportementales, il peut y avoir différents regards, qui se complètent. Quand Olivia Guillon parle des poids économiques des différents acteurs et pointe le fait que, dès qu’un des acteurs a un poids plus fort, il y a un déséquilibre dans la relation, qui a des conséquences sur le plan psycho-social, elle nous donne une clef de compréhension. Nous avions organisé des webinaires, qui avaient réuni en duo ces cinq spécialistes, mais c’était la première fois que nous pouvions les réunir ensemble. Qu’ils soient présents tous les quatre a créé une synergie très intéressante et riche. Une deuxième table ronde, modérée par Maïa Bensimon, désormais déléguée générale du Snac, a réuni, entre autres personnes, le juriste du Syndicat national de l’édition, Julien Chouraqui, et Serge Ewenczyk, du Syndicat des éditeurs alternatifs (SEA). Nous y avons envisagé les solutions possibles. Julien Chouraqui nous a présenté le projet, en cours d’élaboration, de la création d’une Commission de médiation entre auteurs et éditeurs. A été évoquée également la possibilité d’appeler la cellule d’écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour les professionnel.les de la culture, mise en place par le groupe « Audiens ». La question se pose de savoir si cette cellule peut être appelée en cas de harcèlement moral. Différentes avancées sont donc à noter. Dans le public d’une quarantaine de personnes étaient présents des étudiant.e.s, des autrices et auteurs, des éditeurs.trices, un directeur de collection, etc. À la suite de chacune des tables rondes a eu lieu un échange avec le public. C’était très bien de pouvoir parler des dérives comportementales avec tous les acteurs, auteurs comme éditeurs, afin de pouvoir poser des mots, dans un dialogue ouvert, qui reconnaissait l’existence de ce mal-être, d’un côté comme de l’autre. Nous avons mis le doigt sur certains manques, certains vides : le contrat d’édition ne concerne que l’exploitation de l’œuvre, et ne cadre absolument pas la relation de travail. Tous ont pu prendre conscience de cette situation. Nous avons recherché ensemble des solutions, qui sont importantes pour tout le monde. B.A. – Cette journée a été accueillie par la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP). G.H. – Le Snac-BD a un lien fort avec l’ADAGP, en partenariat de laquelle nous avons publié notre contrat commenté, et publions chaque année notre calendrier des autrices et auteurs de Bande dessinée. B.A. – Quelles suites seront-elles données à cette journée ? G.H. – Nous avons enregistré les échanges, qui pourront être la base d’un « verbatim », et d’une vidéo sur le site du Snac. Nous nous proposons de publier une compilation des interventions, nous y joindrons des pistes qui orienteront les personnes vers quoi faire en cas de harcèlement moral, de violences sexuelles et sexistes. Cette publication pourrait advenir en même temps que « Quai des Bulles », le festival de Saint-Malo, en octobre prochain.
Une journée de la Sacem autour de la musique dans le jeu vidéo – Un entretien avec Christophe Héral

Actualités Une journée de la Sacem autour de la musique dans le jeu vidéo – Un entretien avec Christophe Héral, compositeur de musique pour le cinéma d’animation et le jeu vidéo, représentant du groupement Musiques à l’image. Bulletin des Auteurs – Vous avez accordé l’année dernière un entretien au « Bulletin des Auteurs » sur les problèmes contractuels que rencontrent les compositeurs de musique pour le jeu vidéo. La situation a-t-elle évolué ? Christophe Héral – De plus en plus d’artistes-auteurs, d’éditeurs cherchent l’opportunité de placer leurs œuvres dans l’industrie du jeu vidéo. Les retombées économiques des plateformes de diffusion par abonnement, telles que Netflix, Amazon prime…, sont peut-être en deçà de leurs attentes, aussi se tournent-ils vers d’autres contrées afin d’y planter un peu de blé ou d’avoine dans un nouvel « Eldorado ». De plus, la création d’un contrat avec la Sacem attire désormais d’autres modèles économiques vers le jeu vidéo. Alors, Eldorado, peut-être, sauf que le jeu vidéo connaît une crise, depuis près de trois ans. Au sortir du Covid le marché mondial du jeu vidéo s’enthousiasmait, c’était l’éclairage de Noël au village, puis, au fil des ans, les ampoules se sont éteintes, on a rangé les sapins, des sociétés réduisent la voilure, ont du mal à rester en vie, licencient, se retrouvent en redressement judiciaire… On a vu de nombreuses fermetures de Studios de développement. Je l’ai moi-même vécu, en travaillant avec un studio indépendant, qui a dû fermer avant que le jeu ne sorte. Travailler parfois à perte fait partie du jeu. Les studios sont des structures qui restent fragiles, étroitement liées au pouvoir d’achat. Dans des périodes incertaines, là où l’on achetait un jeu par mois, on fait durer un jeu plus d’un trimestre ; le marché de seconde main reste important. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes face à un monde qui va mal. B.A. – Quelle est la différence entre la musique de librairie et la musique originale ? Ch.H. – Pour une somme relativement modeste, un grand studio français a obtenu la totalité du catalogue de « APM », un des plus gros libraires américains, pour la production d’un de ses jeux. Un très joli thème au piano, issu de ce catalogue, devenu un des thèmes principaux de ce jeu, a été repris par la Prévention routière pour une publicité télévisée quelques mois à peine après la sortie. Imaginez qu’une publicité utilise cette musique pour vendre des couches pour les personnes âgées, je ne suis pas certain que cela soit une bonne image pour le jeu en question. La musique originale coûte plus cher qu’une musique de librairie, mais elle garantit l’exclusivité. Si l’éditeur de la musique de jeu vidéo décide de la vendre pour une autre destination, la cession donnera lieu à un nouvel accord, un nouveau contrat pour le compositeur, comme cela est pratiqué dans le cinéma. C’est donc l’éditeur qui décidera de son exploitation. B.A. – La Sacem a organisé une journée en novembre dernier autour de la musique dans le jeu vidéo. Ch.H. – Cette journée était intéressante parce que l’auditorium « Maurice Ravel » était rempli de personnes issues d’horizons différents. C’est un signe de bonne santé de voir des univers artistiques, économiques variés dans une même industrie. J’ai trouvé cette journée très positive parce que j’ai eu l’impression de m’être battu pour la rémunération proportionnelle, le contrat tripartite et finalement d’être arrivé à trouver une solution acceptable pour la Sacem, les éditeurs de jeux vidéo et pour les compositeurs.trices. Il était stupide de faire face à des blocages pour des questions de nationalité ou de droits d’auteur. Qu’importe que les compositeurs et compositrices soient bons ou mauvais, le fait d’être français ou européens suffisait pour se retrouver blacklisté. B.A. – Vous êtes plus optimiste que l’année dernière sur l’accord tripartite ? Ch.H. – Je vois qu’il se met en place. Ce n’est pas rapide mais on revient de loin, parce que beaucoup de gens, dans les studios et dans les associations, voire même certains syndicats qui gravitent autour du jeu vidéo, y étaient quand même hostiles, parce qu’il fallait passer par la Sacem. Celle-ci a mis du temps à réagir, mais elle a réagi, a su rectifier le tir, en mettant de la ressource humaine en la personne de Louis Fritsch, dans l’équipe de Thomas Zeggane et Simon Lhermitte, qui s’occupe désormais exclusivement du jeu vidéo. Aujourd’hui nous avons un interlocuteur. B.A. – Hors Sacem, peut-on travailler dans le respect du CPI ? Ch.H. – Il existe des sociétés qui font l’interface entre les compositeurs et les studios de jeux vidéo, qui disposent d’un panel de compositeurs lorsqu’un studio de jeu vidéo fait appel à leurs services. Elles peuvent aiguiller un compositeur membre de la Sacem pour établir un contrat tripartite, proposer un système qui est légal, au compositeur un contrat, une rémunération proportionnelle, tout comme le système Sacem. B.A. – La journée organisée par la Sacem était pour promouvoir l’accord tripartite ? Ch.H. – Exactement, c’était pour dire, si je résume en trois mots : « Stop, c’est possible ! » C’est une excellente chose, pour les compositeurs, pour les grosses structures de catalogue de musique pré-existante, et pour les librairies musicales. Tout le monde se retrouve à l’abri juridiquement, et peut choisir un compositeur français. Il ne faut pas oublier que le système imposé par certains studios était le « Buy Out », le « Work for Hire », c’est-à-dire la cession totale des droits, patrimoniaux et moraux, ce qui est contraire au code de la propriété intellectuelle. Restent les Anglais qui permettent à la fois le « Buy Out » et/ou la gestion collective, mais sont-ils vraiment européens ?
Les conséquences de la restriction du Pass Culture – Un entretien avec Christian Lerolle

Actualités Les conséquences de la restriction du Pass Culture – Un entretien avec Christian Lerolle, coloriste, représentant du groupement Bande dessinée. Bulletin des Auteurs – Quelles sont les conséquences de la restriction du Pass Culture ? Christian Lerolle – Je suis coloriste de BD depuis trente ans, je fais partie d’un atelier d’auteurs de Bande dessinée qui a aussi trente ans d’existence, « Atelier 510 TTC », qui réunit les différents métiers de la bande dessinée, scénaristes, dessinateurs, coloristes. Depuis le début nous intervenons en milieu scolaire, nous accueillons des stagiaires. Durant une longue période, intervenir en milieu scolaire était compliqué. Selon les établissements, la rémunération était tributaire d’un protocole complexe, personne ne comprenait le statut d’artiste auteur. Nous avons alors monté une association de loi 1901, qui a géré l’administration de nos interventions. Quand le Pass Culture est arrivé, en tant qu’association nous avons pu nous inscrire sur la plateforme « Adage », la plateforme de l’éducation artistique et culturelle. Nous avons créé une page, sur laquelle nous publions nos offres d’ateliers et d’interventions, que les établissements peuvent voir, et réserver, toujours sur Adage. Le plus souvent les établissements ont entendu parler de nous, ils nous contactent, nous montons le projet ensemble, une fois notre devis accepté nous créons l’atelier ou la rencontre sur Adage, et l’établissement valide la proposition. Nous sommes ensuite rémunérés par cette même voie. Cela permet de centraliser, que les dépenses soient transparentes, et que le processus soit beaucoup plus simple. Le dispositif a bien fonctionné. Nous sommes basés à Reims, dans le département de la Marne, nous intervenons dans la Région Grand Est, en Champagne-Ardennes. Cela va de l’école maternelle rurale jusqu’à la fac, en passant par la prison, les Ehpad, les formations. Le Pass Culture est un outil super pratique, tant pour les intervenants que pour les établissements. Je suis l’un des plus vieux membres du comité de pilotage du Snac BD, adhérent à l’ADAGP, membre de la commission Bande dessinée de l’ADAGP, et membre du jury d’attribution des dotations de l’ADAGP aux artistes-auteurs. J’ai fait partie du jury du concours BD scolaire du festival d’Angoulême durant dix-huit années. En tant que coloriste j’ai une vision globale du métier, je connais beaucoup d’auteurs, d’éditeurs, j’ai été témoin des difficultés des auteurs pour s’inscrire sur Adage, car il faut un numéro de Siret, ne pas être allergique aux démarches administratives, mais le mécanisme se mettait en place et prenait une vitesse de croisière intéressante pour tout le monde. Le décret ministériel du 27 février 2025 qui restreint l’assiette et les montants du Pass Culture a été publié sans préavis ni concertation. Il a fait perdre à beaucoup de gens des interventions, des rencontres. Cette atteinte à la diffusion de la Culture dans les établissements, de plus à cette période de l’année, est fort dommageable. Le printemps est propice à de telles interventions et rencontres organisées par les enseignants, qui ont alors couvert la majeure partie de leur programme. Le travail fourni en amont, pour planifier ces rencontres, ces ateliers, avec des établissements qui ont monté un projet, sollicité des auteurs et autrices, est perdu. Au titre des activités et revenus accessoires au droit d’auteur, ce genre d’interventions et de rencontres fait réellement partie des revenus de nombre d’autrices et auteurs de Bande dessinée, notamment illustrateurs Jeunesse, qui survivent grâce à ces revenus complémentaires. En fait, on nous replace dans une période de confinement. Le confinement lors du Covid avait signifié l’arrêt total de nos activités, sur cette même période de l’année. Le Covid a pu nous faire perdre jusqu’à un tiers de nos revenus annuels. C’est la même chose aujourd’hui, en deux jours. En deux jours il fallait en vitesse inscrire sur Adage, et valider les offres d’ateliers ou d’interventions déjà programmées conjointement par les établissements et les artistes auteurs, mais pas forcément encore mis en ligne sur Adage parce que prévus pour dans quelques mois. Les premiers arrivés étaient les premiers servis, jusqu’à épuisement du budget. Le site dès le vendredi matin de l’annonce saturait, on ne pouvait plus y accéder pour valider dans les temps. Énormément de gens ont perdu de l’argent un un temps record, j’ai des exemples d’autrices et auteurs qui en une nuit ont perdu deux à trois mille euros du fait de cette déprogrammation. Ce qui est paradoxal, c’est qu’on arrive à de telles situations par des décisions gouvernementales et ministérielles, alors que les autrices et auteurs sont désormais obligés de payer à l’Urssaf des cotisations et prélèvements sociaux prévisionnels, appelés en amont, et basés sur leurs revenus enregistrés de l’année « n-1 ». L’Urssaf Limousin n’a pas encore intégré la réalité de la fluctuation des revenus, d’une année sur l’autre, des artistes-auteurs. Elle persiste à les traiter comme des entreprises, qui ont un chiffre d’affaires relativement régulier. Pour éviter d’avoir à verser des sommes prévisionnelles, vous pouvez aller sur votre page personnelle et mettre votre prévisionnel à zéro. Et à la fin de l’année vous payez réellement ce qui est vraiment dû. Mais les artistes auteurs ne connaissent pas cette possibilité. Les artistes auteurs vont donc devoir avancer des sommes d’argent calculées sur un revenu qui incluait les revenus accessoires, quand en même temps on vient de leur supprimer ces revenus accessoires. On voit bien que cela a été fait sans aucune consultation de la base ni des organisations professionnelles des autrices et auteurs. C’est du grand n’importe quoi. À Reims avec mon atelier nous organisons un concours BD depuis plus de quinze ans pour les adolescents, ainsi que le « Festival Interplanétaire de Bande dessinée de Reims » (FIBDR). Depuis treize ans nous y invitons une cinquantaire d’auteurs. L’association qui organise le FIBDR invite également, hors festival, des autrices et auteurs à la rencontre du public grâce au Pass Culture. Nous créons par ailleurs des expositions pour les journées européennes du Patrimoine, nous faisons ainsi entrer la Bande dessinée dans les bâtiments, avec des thématiques adaptées aux lieux tels le Palais de Justice, « Michel Vaillant » au musée de l’automobile, etc. Ces expositions tournent ensuite dans les centres